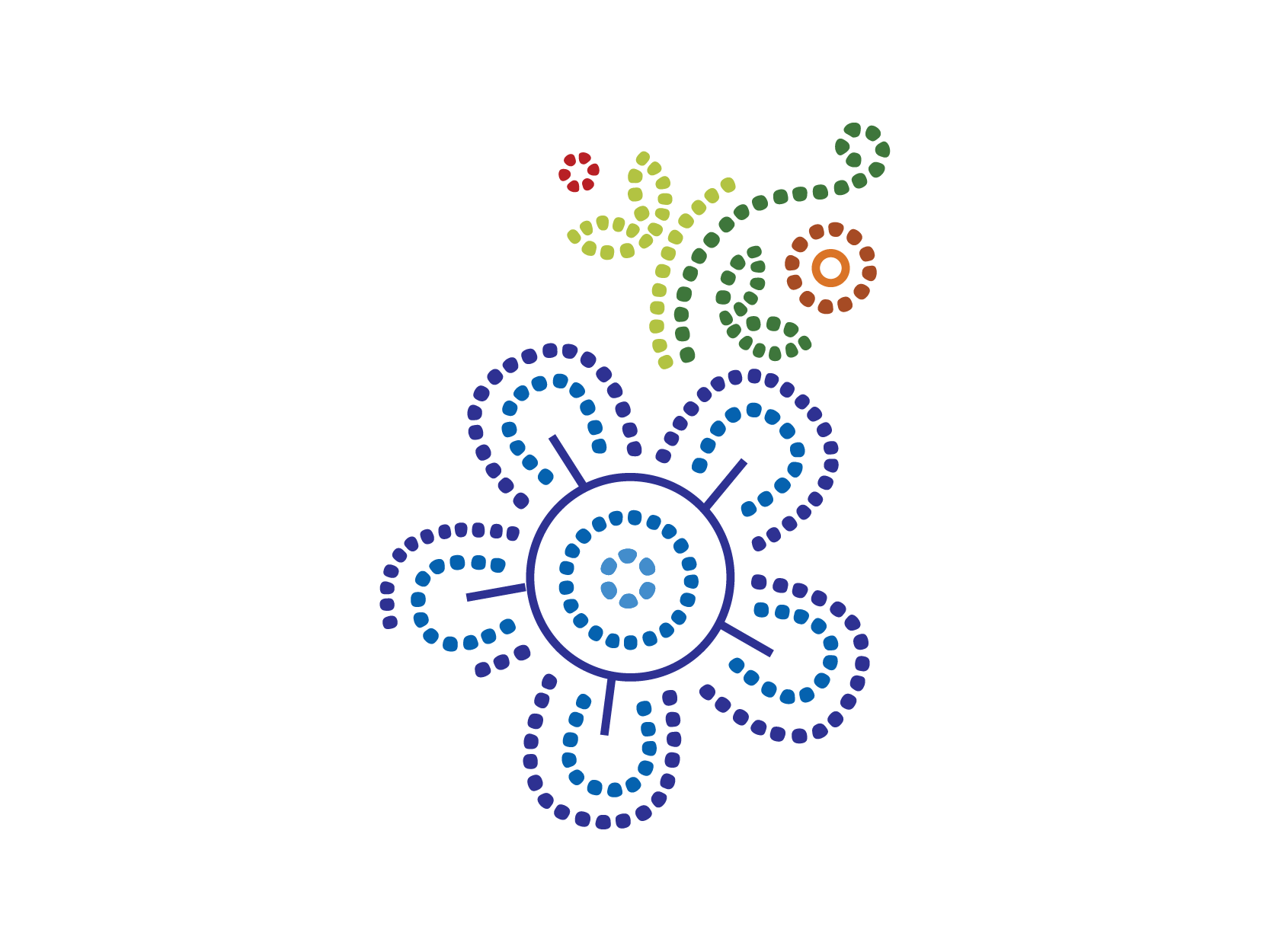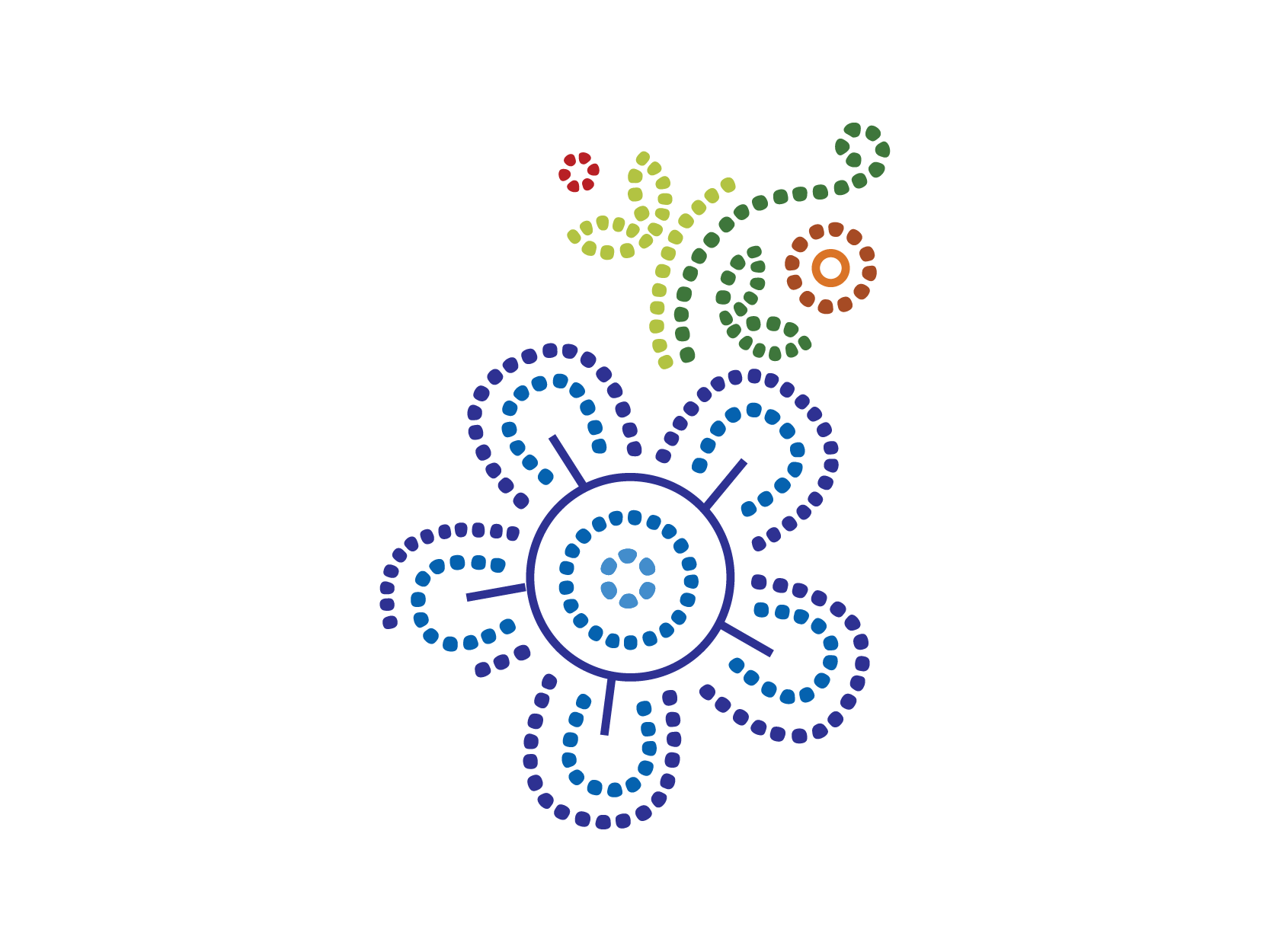Les excuses
Les excuses suivantes ont été présentées pour la première fois le 3 juin 2025 par le conseil exécutif national de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers (FCSII) à l’ouverture du 22e congrès biennal de la FCSII à Niagara Falls, en Ontario.
Au nom des membres de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers, le conseil exécutif national de la FCSII a présenté des excuses aux peuples autochtones qui ont subi des préjudices en raison du manque de soins de santé, de soins contraires à l’éthique et du manque de défense des droits de la part des infirmières et infirmiers pour leurs besoins de santé, ainsi que du racisme constant dans les soins de santé d’aujourd’hui.
La FCSII est la plus grande organisation infirmière au Canada. Elle représente les infirmières et infirmiers syndiqués de première ligne de tous les secteurs de soins (soins à domicile, soins de longue durée, soins communautaires et actifs), ainsi que les étudiantes et étudiants en sciences infirmières. En tant que l’une des principales organisations de défense des soins de santé au pays, la FCSII a le devoir et la responsabilité de veiller à la réconciliation et à la sécurité des personnes autochtones qui reçoivent des soins.
La FCSII s’emploie à devenir un défenseur de confiance des Autochtones depuis que Jordan River Anderson, de la nation crie de Norway House, au Manitoba, a été hospitalisé dès la naissance, car il souffrait d’un trouble de santé rare. Il a vécu plus de deux ans à l’hôpital parce que les gouvernements n’ont pas fait ce qu’il fallait et ont simplement discuté de qui allait payer ses soins. Il est inacceptable que les Autochtones continuent d’être confrontés au racisme dans les soins de santé aujourd’hui. Pour aller de l’avant, nous devons d’abord nous excuser de notre inaction passée et des expériences actuelles de racisme auxquelles font face les peuples autochtones, et poursuivre nos efforts afin de jeter des bases solides pour les générations futures. Les personnes autochtones méritent d’excellents soins, et nous nous engageons à faire mieux.
« La réconciliation est un processus qui se construit.
Ce n’est pas un sport passif. Elle concerne tout le monde.
Et tout le monde est impliqué, que cela nous plaise ou non.
On est pour ou contre. On ne peut pas être neutre.
Et quand on pense à la réconciliation, on doit la comprendre.
Comprendre fait partie du processus d’éducation.
Et comprendre les conséquences qu’elle a pour nous
fait partie du défi auquel nous devons aussi faire face. Tout ceci est lié à la connaissance, ainsi qu’au dialogue. Il s’agit d’en venir à un consensus et de convenir de la direction que prendra notre pays... Nous devons parler du type de relation que nous allons entretenir à l’avenir. Cela signifie que nous devons penser différemment. Nous devons penser mieux... »
– L’honorable Murray Sinclair, sénateur et commissaire en chef de la Commission de vérité et de réconciliation, lors d’une allocution prononcée au Tommy Douglas Institute du Collège George Brown à Toronto, en Ontario, le 28 mai 2018.
Introduction
Nous commençons par reconnaître les gardiens et les intendants traditionnels de ces terres sur lesquelles nous vivons et prospérons. D’est en ouest et jusqu’au nord, nous rendons hommage aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, aux détenteurs du savoir et aux Aînés du passé, du présent et émergents. Nous comprenons que ces terres sont et seront toujours autochtones, même si elles portent collectivement le nom de Canada depuis la colonisation. Nous reconnaissons que les peuples autochtones actuels et les générations futures auront besoin d’être soignés d’une manière qui favorise les obligations relationnelles. Nous reconnaissons que nous avons également la responsabilité de cultiver des relations avec eux, mais que la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers doit faire mieux.
Les peuples autochtones doivent être entendus et respectés. Ils méritent les meilleurs soins possibles dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements des soins de longue durée. Ils méritent de se sentir en sécurité sous nos soins, et de croire que le personnel infirmier défend leurs intérêts de manière efficace. Au lieu de cela, le Canada et le système de soins de santé ont causé du tort aux peuples autochtones, et nous devons leur présenter nos excuses pour le rôle que nous avons joué. En tant qu’infirmières et infirmiers, nous devons faire face à notre passé avec honnêteté et humilité. Cette vérité doit précéder une réconciliation significative.
La colonisation dans les soins de santé
Les programmes de sciences infirmières au Canada sont fondés sur la science biomédicale occidentale, un système qui a historiquement ignoré, rejeté et méprisé le savoir autochtone. Alors que les soins de santé occidentaux mettent l’accent sur la personne, la perspective autochtone du bien-être et des déterminants sociaux de la santé est holistique et ancrée dans la communauté, la terre, les cérémonies et l’interconnexion.
Les soins de santé occidentaux ont cherché à supprimer le savoir autochtone. Au lieu de collaborer avec les peuples autochtones dans le cadre de ce qui est considéré comme une bonne santé, ils ont rejeté le savoir autochtone comme s’il s’agissait de folklore et de connaissances non pertinentes ou non scientifiques, jouant ainsi un rôle important au Canada dans l’invalidation ou le rejet du savoir autochtone. Ce rejet n’est pas neutre; il est colonial.
Les gouvernements coloniaux ont appliqué ces approches en adoptant des lois et des politiques qui criminalisaient les cérémonies, les langues et les pratiques culturelles autochtones. Ces actions constituent une violation des droits de la personne. Nous savons que la cérémonie fait partie du bien-être autochtone et représente un magnifique moyen de conserver l’équilibre avec la terre et les autres. Elle est essentielle. Aujourd’hui, nous reconnaissons les préjudices profonds causés par le rejet du savoir autochtone en matière de bien-être, ce qui était fondamentalement inacceptable. Aujourd’hui, nous constatons que ce rejet contribue au racisme à l’égard des peuples autochtones.
Aujourd’hui, nous présentons nos excuses aux peuples autochtones : nous ne vous avons pas écoutés, nous avons dévalorisé la sagesse qui a soutenu vos communautés pendant des générations et nous avons rejeté le savoir qui vous a permis de rester en bonne santé pendant d’innombrables générations. Les véritables soins de santé doivent être cocréés et ancrés dans le respect, la réciprocité et la reconnaissance que le savoir autochtone n’est pas seulement valide, mais vital. [1]
Refus de fournir des soins de santé
Le système de santé et la science qui le sous-tend n’ont pas servi les peuples autochtones de manière équitable, respectueuse ou juste. Le système a en fait refusé activement de les servir dans bien des cas.
Les pensionnats indiens étaient conçus en fonction du mandat colonial, soit, pour reprendre les mots du premier ministre d’alors, John A. Macdonald : « tuer l’Indien dans l’enfant ». Ces établissements sont devenus des lieux de négligence systémique, de maltraitance et de décès. Les enfants n’y recevaient pas de soins de santé, ou recevaient des soins qui n’étaient pas comparables à ceux prodigués à tout autre enfant canadien. Des milliers d’enfants sont morts de maladies évitables, notamment la tuberculose, car on leur refusait les soins de santé les plus élémentaires.
Les politiques fédérales demandaient aux professionnels de la santé de fournir des services « inférieurs » à ceux offerts à tout autre Canadien. Le personnel de la santé, y compris les infirmières, n’a pas remis en question ces politiques et n’a donc pas protégé les enfants autochtones. Dans les pensionnats, des infirmières étaient présentes lors des expériences médicales et nutritionnelles contraires à l’éthique. Nous reconnaissons que le personnel infirmier a été complice de la négligence et de la maltraitance des enfants autochtones. Au lieu de défendre le bien-être des enfants des Premières Nations, inuits et métis, les infirmières se sont rendues complices de leurs souffrances.
Les décisions de mal servir ou de ne pas servir les Autochtones n’étaient pas seulement contraires à l’éthique, mais également profondément racistes. Le secteur des soins de santé était parfois d’accord avec la théorie raciste selon laquelle les Autochtones étaient génétiquement inférieurs et donc plus susceptibles à la maladie. Cette attitude a nourri le racisme systémique et contribué aux inégalités dévastatrices auxquelles les communautés autochtones continuent d’être confrontées aujourd’hui. Les politiques du gouvernement et des soins de santé qui ont engendré ces inégalités, ainsi que le racisme, sont inacceptables. Les infirmières fournissaient des soins inadéquats et n’ont pas dénoncé les conditions déplorables qui menaient à la propagation de la maladie et à la mort, et elles n’ont donc pas respecté les normes d’éthique. Nous n’avons pas protégé les enfants. Nous n’avons pas dénoncé l’inhumanité qui se manifestait dans les établissements où nous travaillions.
Nous présentons nos plus profondes excuses aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis pour notre inaction, pour nos gestes qui leur ont causé des préjudices, et pour les préjudices causés par notre silence. Nous nous excusons du refus des soins, de la confiance brisée et des vies perdues. [2]
Hôpitaux pour les Indiens
Des survivants des hôpitaux pour les Indiens ont récemment obtenu le règlement d’un recours collectif qui reconnaît officiellement les profonds préjudices subis par les peuples autochtones. Le gouvernement du Canada a créé ce réseau hospitalier distinct pour les Autochtones, mais tout ce qui avait trait à ces établissements était profondément raciste et visait à séparer les personnes autochtones et à dévaloriser leur vie. Dès leur création, les hôpitaux pour les Indiens ont été caractérisés par une discrimination systémique; ils fournissaient des soins non conformes aux normes, opéraient souvent sans le consentement des patients et violaient les droits de la personne les plus fondamentaux.
Des survivants ont courageusement raconté leur histoire de traitement non consensuel, de maltraitance et de soins qui ne respectaient pas les normes scientifiques – et encore moins les normes éthiques. Des infirmières travaillaient dans ces établissements. Des infirmières étaient présentes. Elles restaient trop souvent silencieuses face à la souffrance. Elles ne défendaient pas les patients. Nous reconnaissons que les infirmières étaient complices.
Nous devons connaître la vérité de l’histoire de notre pays pour comprendre pourquoi la réconciliation est si nécessaire. Les personnes présentes ici aujourd’hui n’ont peut-être pas travaillé directement avec des hôpitaux pour les Indiens, mais nous devons vivre avec cette vérité sur les gestes de notre profession. Nous devons assumer nos responsabilités et comprendre la manière dont les soins infirmiers ont contribué aux préjudices. Nous sommes responsables de veiller à ce que de tels mauvais traitements ne se reproduisent jamais.
Nous ne pouvons pas prétendre défendre la santé et la guérison si nous refusons de reconnaître la douleur qui a été causée. Nous avons profondément honte que notre profession n’ait pas respecté ses propres principes fondamentaux de soins caractérisés par la compassion, l’éthique et l’équité. Le personnel infirmier n’a pas prodigué de soins sûrs en faisant preuve de compassion. Nous n’avons pas protégé les patients des Premières Nations, métis et inuits. Nous présentons humblement nos plus profondes excuses aux peuples des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis pour notre rôle dans ces établissements, pour l’abus de confiance et pour le mal causé.[3]
Reconnaître que nous devons faire mieux
Si nous devons avoir suffisamment de connaissances pour comprendre les raisons historiques de la réconciliation, nous devons également faire preuve d’honnêteté en ce qui concerne les niveaux actuels de racisme dans les soins de santé à l’égard des peuples autochtones. Le racisme menace la sécurité des patients autochtones.
Le racisme systémique qui a conduit à l’existence de lits et d’hôpitaux séparés pour les Autochtones est toujours présent dans les structures et les politiques de nos établissements, et il continue d’avoir des répercussions sur les peuples autochtones aujourd’hui. Le système de santé est encore sous-financé dans les communautés autochtones par rapport au reste du pays. Nous n’avons pas défendu le financement dont les communautés autochtones ont besoin et qu’elles méritent. Nous n’avons pas défendu la justice pour l’équité dans les soins de santé aux Autochtones.
Le racisme dans les soins de santé a longtemps été justifié par des croyances fausses et déshumanisantes : les Autochtones sont génétiquement inférieurs, ils ressentent moins de douleur et ils ne suivent pas les directives de traitement. Ces idées sont enracinées dans l’ignorance et la haine, et elles ont influencé les décisions cliniques, mené au refus de soins nécessaires et causé des traumatismes durables. Lorsque les patients autochtones connaissent de moins bons résultats, le système les blâme souvent au lieu d’examiner la manière dont le racisme et les inégalités ont influencé leurs soins. C’est une erreur. Nous devons assumer notre part de responsabilité et faire mieux.
L’un des exemples les plus horribles de cette violence continue à l’égard des femmes des Premières Nations, inuites et métisses est la stérilisation forcée, qui se produisait encore en 2023, et parfois même à leur insu. Ces actes constituent des violations des droits de la personne, de l’autonomie corporelle et de l’éthique médicale. Des infirmières étaient présentes. Nous n’avons pas empêché ces interventions. Nous avons été complices de l’abus de pouvoir sur un patient, alors que nous aurions dû être les protecteurs du choix, de la sécurité et de la dignité du patient.
Les patients et les familles des Premières Nations, des Métis et des Inuits ne devraient pas se sentir en danger dans le système de santé. Le racisme et le traitement inéquitable auxquels les peuples autochtones sont actuellement confrontés sont inacceptables et menacent la sécurité des patients. C’est une vérité qui doit précéder la réconciliation.
Nous avons honte que les Premières Nations, les Inuits et les Métis soient confrontés au racisme dans les soins de santé aujourd’hui – sur nos lieux de travail. Nous sommes censés être vos défenseurs, et nous vous avons laissé tomber. Nous nous excusons que le racisme continue d’avoir des répercussions sur votre bien-être, et nous vous demandons humblement de nous donner une autre chance de vous témoigner le respect et l’honneur qui vous reviennent de droit.[4]
Infirmières et infirmiers autochtones
Il y a toujours eu des personnes soignantes au sein des communautés autochtones. Lorsque les personnes autochtones sont entrées dans la profession infirmière, elles ont été confrontées au même racisme que leurs familles et leurs communautés ont vécu en tant que patients. Pratiquement tous les infirmières et infirmiers autochtones ici présents, qui regardent en ligne et travaillent pour prendre soin de nos familles, ont vécu du racisme et ont été témoins de racisme envers des patients autochtones. Pendant des décennies, les Autochtones n’étaient même pas autorisés à accéder à la profession infirmière à moins qu’ils ne renoncent à leur identité autochtone. Cette politique discriminatoire n’a pris fin qu’au début des années 1970.
Lorsque nous réfléchissons à l’histoire des soins infirmiers, il est essentiel de reconnaître, d’honorer et d’élever la contribution du personnel infirmier autochtone. En toute humilité, nous leur devons une dette de gratitude pour leur persévérance et leur leadership. Nous devons nous assurer que les histoires des infirmières et infirmiers autochtones sont pleinement intégrées au récit de la profession infirmière. L’une des façons d’honorer les infirmières et infirmiers autochtones est d’affronter le racisme systémique et interpersonnel auquel ils continuent de faire face dans la profession qu’ils ont choisie.
Je ne peux imaginer la force dont font preuve les infirmières et infirmiers autochtones en choisissant d’être ici avec nous aujourd’hui, et je vous en remercie.
Nous ne vous avons pas protégés contre le racisme. Nous n’avons pas tenu compte de vos contributions dans le domaine des soins de santé. Nous vous présentons nos plus profondes excuses, à vous, infirmières et infirmiers des Premières Nations, inuits et métis. Nous vous demandons humblement de nous donner une chance de faire mieux.
Vers l’avenir
La vérité est souvent douloureuse, surtout lorsqu’elle a été cachée. Aujourd’hui, dans cette salle et en ligne, nous nous encourageons mutuellement à être forts pour affronter la vérité. La vérité précède la réconciliation.
Les excuses ne sont qu’un pas vers cet objectif. Elles doivent être suivies par des actions. La FCSII sait que nous sommes responsables de nos actes, et nous sommes déterminés à faire de notre mieux pour parvenir à la réconciliation. Nous reconnaissons que nous détenons le pouvoir dans le système de santé, et nous nous engageons à défendre la sécurité et l’inclusion des peuples autochtones.
Nous sommes en train d’élaborer un plan d’action qui guidera notre voie vers l’avenir. Ce plan est fondé sur la vérité, la responsabilité et la reddition de comptes. Nous demandons humblement aux partenaires autochtones de nous tenir responsables en veillant à ce que nos actes correspondent à nos paroles.
Je m’exprime également à titre personnel. Je m’engage à suivre mon propre parcours d’apprentissage, à développer mes compétences culturelles, à faire preuve d’humilité culturelle et à m’engager en faveur de la sécurité culturelle. Je travaille sur moi afin de pouvoir un jour gagner la confiance nécessaire pour dire : Vous êtes en sécurité avec moi. Nous vous invitons à faire de même.
Nous sommes en train d’apprendre en tant que personnel infirmier, en tant que pairs et en tant qu’amis. Nous continuerons d’apprendre et de renforcer nos compétences et notre capacité à fournir des soins adaptés à la réalité culturelle. Aujourd’hui est une nouvelle étape de notre parcours, et nous ne nous arrêterons pas là. Joignez-vous à nous. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire, dans votre rôle, pour faire progresser la réconciliation. Soutenez-vous les uns les autres. Apprenez ensemble. Dirigez ensemble. Excusez-vous ensemble.
Merci de vous joindre à nous aujourd’hui et de participer au travail de réconciliation.
Glossaire
Modèle biomédical de soins : Un modèle de soins de santé occidental principalement axé sur le diagnostic et le traitement des maladies par le biais de méthodes scientifiques et physiologiques, limitant souvent la prise en compte des facteurs socioculturels, émotionnels et spirituels.
Colonisation : Un processus de domination qui continue de remodeler la vie des peuples autochtones aujourd’hui. Elle déplace les peuples autochtones, perturbe leurs modes de vie, efface la souveraineté, la langue et les pratiques culturelles autochtones et renforce les structures sociales qui perpétuent les déséquilibres de pouvoir et les inégalités systémiques. La colonisation au Canada a créé la domination des colons sur les peuples autochtones et a jeté les bases du racisme envers les Autochtones.
Humilité culturelle : Un processus permanent d’autoréflexion et d’autocritique fondamental visant à atteindre la sécurité culturelle. Ce processus consiste à examiner ses propres hypothèses, croyances et privilèges afin de favoriser des relations fondées sur la confiance mutuelle, le respect, le dialogue ouvert et la prise de décision partagée.
Sécurité culturelle : Un environnement – tel que défini par le bénéficiaire des soins – où les individus se sentent respectés dans leur identité et à l’abri du racisme et de la discrimination. Cela exige que les fournisseurs de soins de santé remédient aux déséquilibres de pouvoir, pratiquent l’humilité culturelle et adoptent des approches antiracistes.
Équité en santé : La poursuite de l’accès des individus et des communautés aux ressources nécessaires pour assurer une santé optimale, en tenant compte des circonstances uniques, en éliminant les obstacles systémiques et en mettant en œuvre des politiques appropriées sur le plan culturel.
Systèmes de connaissances autochtones : L’ensemble complexe de savoirs, de pratiques culturelles et de philosophies développées par les peuples autochtones au fil des générations, profondément liées à la terre, à la langue, à la spiritualité et aux relations communautaires.
Racisme propre aux Autochtones : Stéréotypes et préjugés visant uniquement les peuples autochtones du Canada, enracinés dans l’histoire du colonialisme et perpétuant la discrimination et les inégalités systémiques.
Racisme interpersonnel : Présomptions différentielles sur les capacités, les motivations et les intentions des autres en fonction de leur « race », et actions différentielles basées sur ces présomptions. Les préjugés et la discrimination se manifestent par des actes ou des omissions et peuvent être intentionnels ou non.
Racisme institutionnel ou racisme systémique : Différence d’accès aux biens, services et occasions de la société en fonction de la « race ». Ces types de racisme n’exigent pas d’auteur identifiable et expliquent la différence d’accès au logement, à l’emploi, aux soins de santé et au soutien politique. Ils émergent d’actions et se manifestent par l’inaction, c’est-à-dire l’absence d’action face à un besoin.
Réconciliation : Un processus continu d’établissement et de maintien de relations respectueuses entre les personnes autochtones et non autochtones afin d’aborder les répercussions historiques et actuelles de la colonisation, en reconnaissant les préjudices passés et en collaborant dans le but de parvenir à l’équité.
References
[1] La plus grande partie des programmes de formation en soins infirmiers au Canada reposent sur la science occidentale. Bien que cette dernière nous ait donné beaucoup de raisons d’être reconnaissants, elle a également joué un rôle important dans la colonisation. La science et la médecine occidentales exigent un modèle de soins normalisé qui efface les différences culturelles chez les patients et rejette les déterminants spirituels et sociaux de la santé dans les communautés. La science et les soins de santé occidentaux dévalorisent ou invalident le savoir autochtone et, ce faisant, ont été un élément clé du racisme qui existe à l’égard des peuples autochtones à l’heure actuelle.
Moreton Robinson, A. (éd.). (2020). Sovereign subjects: Indigenous sovereignty matters. Routledge. Cole, D. et Chaikin, I. (1990). An Iron Hand Upon the People: The Law Against the Potlatch on the Northwest Coast. Douglas & McIntyre.[2] La négligence et le racisme systémique régnaient dans les pensionnats, et le surpeuplement, la malnutrition et les soins médicaux et buccodentaires inadéquats entraînaient des taux de mortalité élevés. Des maladies infectieuses comme la tuberculose et la grippe se propageaient librement en raison du manque de ressources et de soins de santé adéquats.
Des recherches médicales contraires à l’éthique étaient aussi menées dans les pensionnats. Des enfants étaient soumis à des expériences nutritionnelles qui servaient en partie à éclairer les politiques fédérales en matière de nutrition, notamment des aspects du Guide alimentaire canadien. Ces expériences comportaient souvent la privation délibérée de nutriments essentiels, ce qui laissait les enfants affamés, causait des dommages immédiats et contribuait à des problèmes de santé à long terme, y compris un risque accru de maladies chroniques, telles que le diabète.
Woolford, A. (2015). This benevolent experiment: Indigenous boarding schools, genocide, and redress in Canada and the United States. University of Nebraska Press.
Mosby, I. (2013). Administering colonial science: Nutrition research and human biomedical experimentation in Aboriginal communities and residential schools,1942–1952. Histoire sociale/Social History, 46(1), 145–172.
https://doi.org/10.1353/his.2013.0015
[3] Tout comme les pensionnats indiens, les 29 hôpitaux pour les Indiens établis partout au pays ont laissé un tragique héritage de douleur et de souffrance. Ces hôpitaux ont été créés au milieu du 20e siècle sous prétexte de lutter contre les épidémies de tuberculose dans les communautés autochtones.Ils servaient principalement à séparer les patients autochtones du système général de soins de santé. Les femmes inuites ont également été disproportionnellement touchées par les évacuations médicales au milieu du 20e siècle, durant lesquelles un grand nombre d’entre elles ont été séparées de leur famille, parfois indéfiniment, afin d’être traitées dans des établissements dans le sud. Ces politiques ignoraient couramment les structures sociales autochtones, soumettaient les femmes à des pratiques de stérilisation coercitives et engendraient des traumatismes intergénérationnels durables. Au lieu de refléter un engagement véritable envers le bien-être des Autochtones, ces établissements incarnaient la violence coloniale, la peur et le racisme systémique. Ils étaient réputés pour leur manque de personnel et leur sous-financement et caractérisés par des soins de mauvaise qualité. Ils sont par ailleurs devenus des lieux d’actes médicaux invasifs et contraires à l’éthique, dont plusieurs étaient exécutés sans aucun type de consentement éclairé. Les traumatismes infligés par ces hôpitaux ont laissé des traces durables sur les personnes, les familles et les communautés, renforçant la méfiance à l’égard des systèmes de soins de santé et contribuant à la persistance des disparités en matière de santé.
Lux, M. K. (2016). Separate beds: A history of Indian hospitals in Canada, 1920s–1980s. University of Toronto Press.
Geddes, G. (2017). Medicine unbundled: A journey through the minefields of Indigenous health care. Heritage House Publishing Co.
Gouvernement du Canada. (2025, 19 mars). Accord final pour régler le recours collectif Hardy. Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord/nouvelles/2025/03/accord-final-pour-regler-le-recours-collectif-hardy.html
[4] Le racisme institutionnel fait partie du racisme systémique, car il est ancré dans les politiques, les pratiques et les structures des organisations etdes institutions (p. ex. les hôpitaux, les universités et les gouvernements) et entretient les disparités raciales en limitant l’accès équitable aux ressources, auxoccasions et aux postes de direction. Un autre exemple est l’allocation inégale des ressources et les protocoles de triage biaisés dans les services d’urgence, qui placent les patients autochtones à un niveau de priorité inférieur. De même, l’absence de services d’interprétation fait qu’il est difficile pour les patients decommuniquer les symptômes, de comprendre les diagnostics ou de défendre leurs soins, surtout lorsque certaines langues autochtones n’ont pas de traductiondirecte pour des concepts tels que la douleur.
Université de la Colombie-Britannique. (2020). In Plain Sight: Addressing Indigenous-specific racism and discrimination in BC health care. Vancouver, C.-B. :Ministère de la Santé. In-Plain-Sight-Full-Report-2020.pdf
Symenuk, P. M., Tisdale, D., Bearskin, D. H. B., et Munro, T. (2020). In search of the truth: Uncovering nursing’s involvement in colonial harms and assimilative policies five years post Truth and Reconciliation Commission. Witness: The Canadian Journal of Critical Nursing Discourse, 2(1), 84–96. https://doi.org/10.25071/2291-5796.51
Comité sénatorial permanent des droits de la personne. (2022, juillet). The scars that we carry: Forced and coerced sterilization of persons in Canada – Part II.